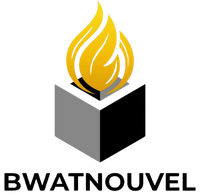Il est de ces parcours qui racontent à eux seuls la force tranquille d’une génération décidée à ne plus se contenter des limites de son environnement. Jackson Merinor appartient à cette lignée rare de jeunes intellectuels haïtiens qui, entre lucidité et persévérance, transforment les obstacles d’un pays meurtri en tremplin pour la pensée. De Maniche à Paris-VIII, son itinéraire se lit comme un récit d’apprentissage, une quête de courage et de savoir, où chaque étape révèle une conviction: celle que la connaissance peut devenir un acte de résistance et de reconstruction.
Né à Maniche (Les Cayes), dans le Sud d’Haïti, il grandit dans un environnement modeste mais riche en valeurs humaines. Très tôt, il comprend que l’école n’est pas seulement un passage obligé, mais une voie d’émancipation, de changement et de réussite. Ses années au Foyer Notre-Dame de l’Espoir, puis au Centre Don Bosco Riobé à Gressier, forgent en lui une rigueur et une curiosité peu communes. D’ailleurs, c’est là, entre les murs d’écoles rurales, qu’il découvre son goût pour la réflexion politique et son sens du collectif, un trait qui deviendra la signature de tout son parcours.
En 2015, il intègre l’INAGHEI (Institut National d’Administration, de Gestion et des Hautes Études Internationales), au sein de l’Université d’État d’Haïti. Un passage marqué par diverses responsabilités. En effet, dans un espace universitaire souvent confronté au manque de moyens, il choisit de ne pas subir, mais d’agir. Il s’investit dans la vie étudiante, représente le département de science politique, anime les débats, et finit par relancer, après plus de quarante années de silence, la revue Les Cahiers de l’INAGHEI, un journal de la faculté.
Cet acte symbolique dépasse un simple geste académique : il redonne souffle à une tradition intellectuelle Inagheinne oubliée à l’époque, parce qu’il croit profondément que la pensée critique doit retrouver sa place dans la société, et que la jeunesse a le devoir d’y participer. C’est pourquoi, il écrit, encadre, coordonne et prouve qu’en Haïti aussi, il est possible de produire du savoir avec dignité et exigence.
De plus, son mémoire de fin d’études, soutenu avec la mention Excellent (92/100), portée sur « La coopération haïtiano-taïwanaise au regard des Objectifs de Développement Durable (2009–2019) ». À travers cette étude, Merinor explore la place d’Haïti dans la géopolitique mondiale et questionne la durabilité d’une coopération souvent plus symbolique qu’efficace. Cette réflexion, à la fois lucide et rigoureuse, attire l’attention. En effet, elle révèle chez lui une capacité rare: celle de relier les enjeux diplomatiques globaux à la réalité nationale. D’ailleurs, c’est cette même approche qu’il poursuivra ensuite à l’international, toujours guidé par un fil rouge: comprendre comment les institutions façonnent les peuples, et comment les peuples peuvent, à leur tour, transformer les institutions.
Après l’INAGHEI, il poursuit sa formation à l’étranger où il obtient un Master en science politique à l’Université Tamkang, à Taïwan, où il soutient en juin 2024 un mémoire portant sur la stratégie de rééquilibrage des États-Unis sous la présidence de Barack Obama dans la région Asie-Pacifique. Cette étape asiatique, peu commune pour un Haïtien, ouvre en lui une dimension nouvelle : la rencontre des civilisations et la conscience de la place du Sud global dans les reconfigurations du monde. Pour lui, l’expérience taïwanaise est fondatrice, elle l’initie à la rigueur académique internationale, au dialogue interculturel et à une vision comparée des systèmes politiques. Elle prouve surtout que la jeunesse haïtienne peut, au-delà des frontières, s’imposer par la compétence et la constance.
Aujourd’hui, il est doctorant à l’Université Paris-VIII, Vincennes–Saint-Denis, affilié au CRESPPA–LABTOP, un prestigieux laboratoire de recherche en sciences politiques. Sous la direction du professeur Michel Mangenot, il prépare une thèse intitulée:« L’institutionnalisation de la présidence du Conseil européen depuis 2009 : entre influence, rôle politique et interactions ». On pourrait croire que choisir un sujet aussi dense serait une manière d’aller vers l’Europe, au contraire, il y voit une possibilité de décoder les rouages du pouvoir à l’échelle mondiale. Car, comprendre comment s’organise la direction politique du continent européen, c’est aussi interroger la manière dont les institutions peuvent gagner ou perdre leur légitimité. Et dans ce questionnement, il y a toujours Haïti: ce pays dont les institutions vacillantes, appellent à être repensées, consolidées, réinventées.
De Maniche à aujourd’hui, Jackson Merinor s’est imposé comme un symbole d’ouverture. Présent dans divers forums internationaux, collaborateur d’initiatives de recherche, contributeur à des publications en ligne, il incarne une génération d’Haïtiens pour qui l’excellence n’est pas synonyme d’exil, mais de rayonnement. En somme, sa trajectoire invite à réfléchir sur le rôle du savoir dans la reconstruction nationale. Peut-on repenser Haïti sans la voix de ces jeunes chercheurs ? Peut-on rêver d’un avenir collectif sans donner la parole à ceux qui comprennent le monde ? MERINOR, à travers son parcours, répond par l’exemple: oui, la connaissance peut encore changer la trajectoire d’un peuple.
In fine, le parcours de ce jeune haïtien n’est pas seulement une réussite individuelle; c’est un message. Celui d’une jeunesse haïtienne qui, au lieu de se résigner, choisit d’apprendre, de bâtir, de se former, et de partager. Dans un monde qui doute, lui, il prouve que la pensée reste un acte de foi.
Et si son histoire inspire, c’est parce qu’elle nous rappelle une vérité simple: la grandeur ne vient pas de là où l’on naît, mais de ce que l’on décide de faire de sa vie.
Cynthia MAXI