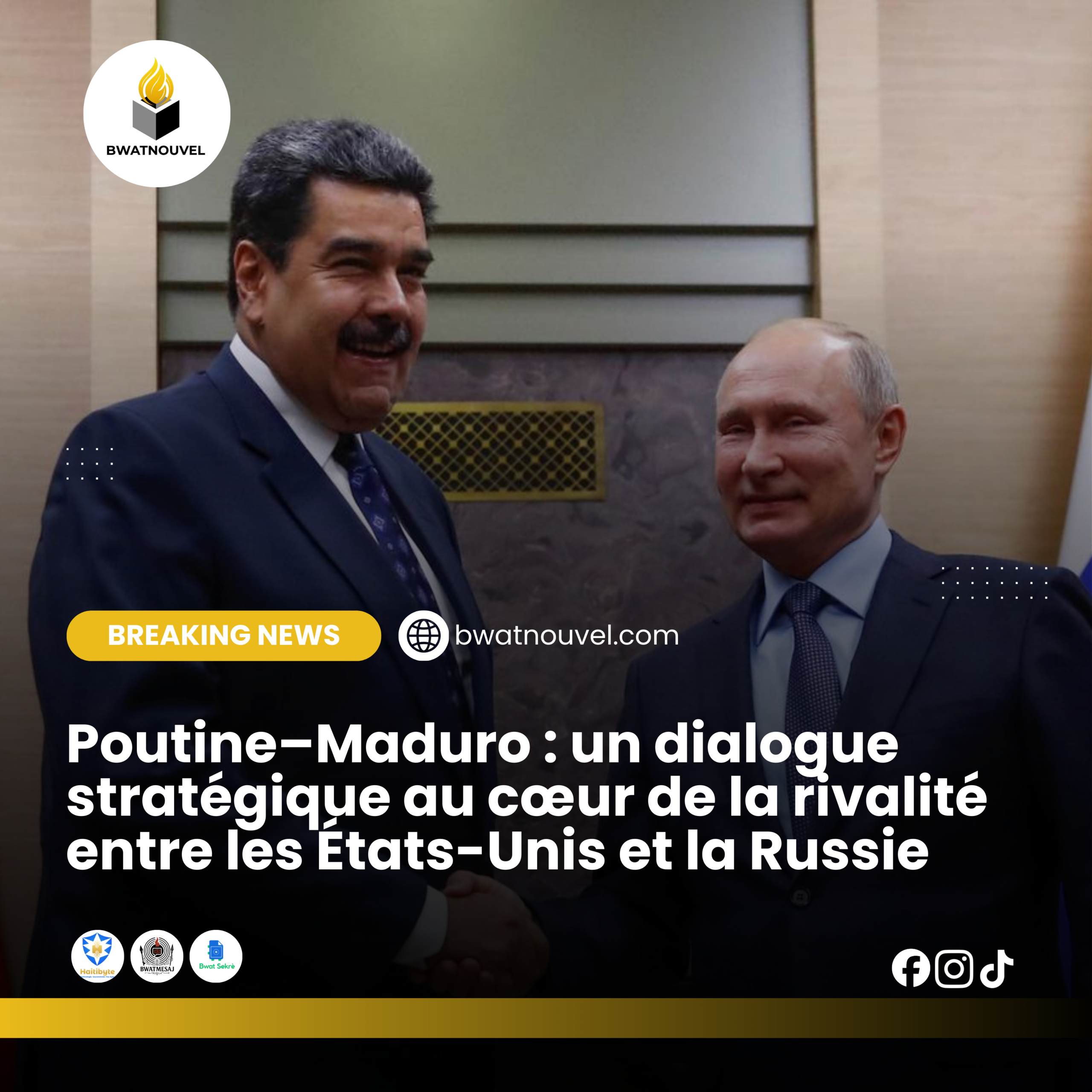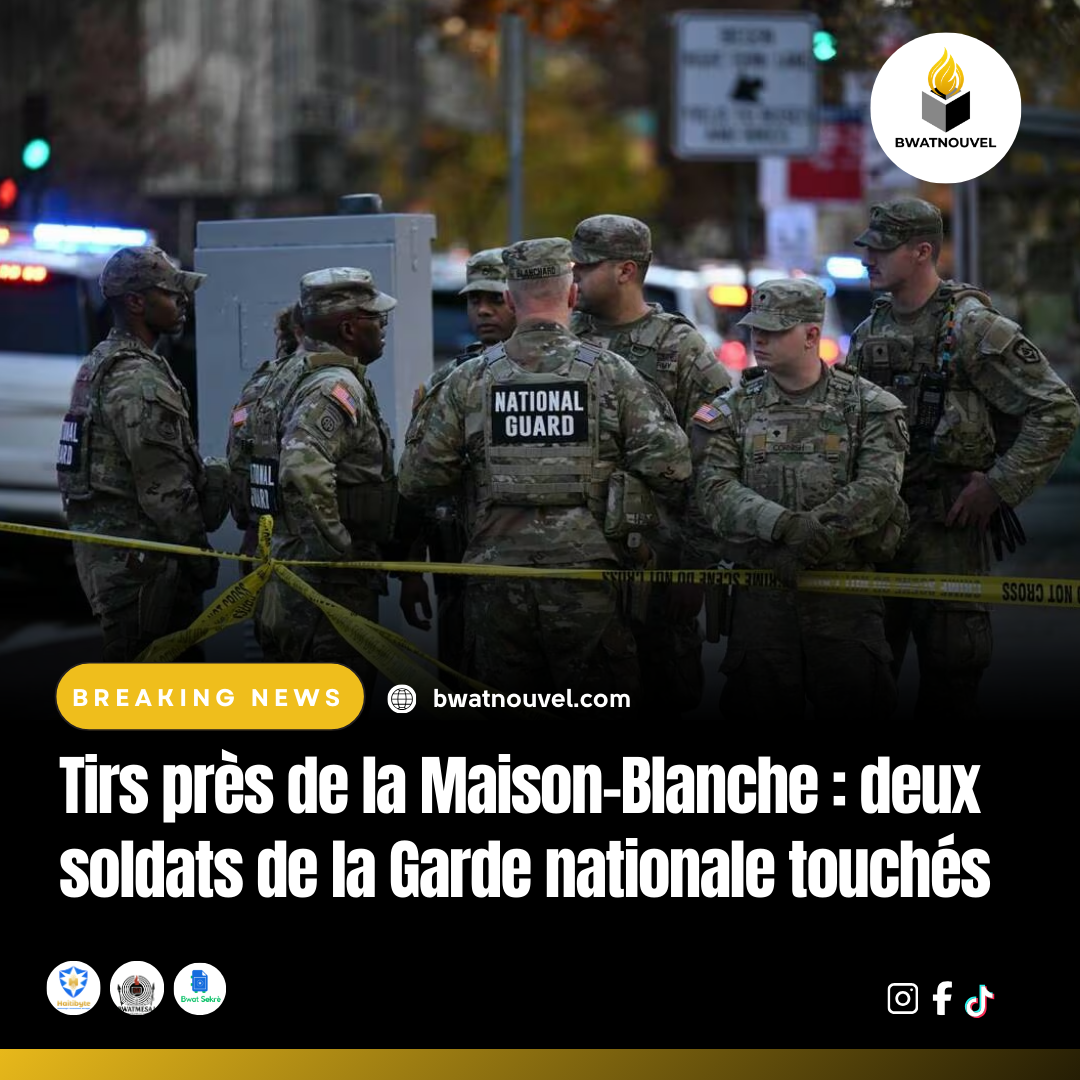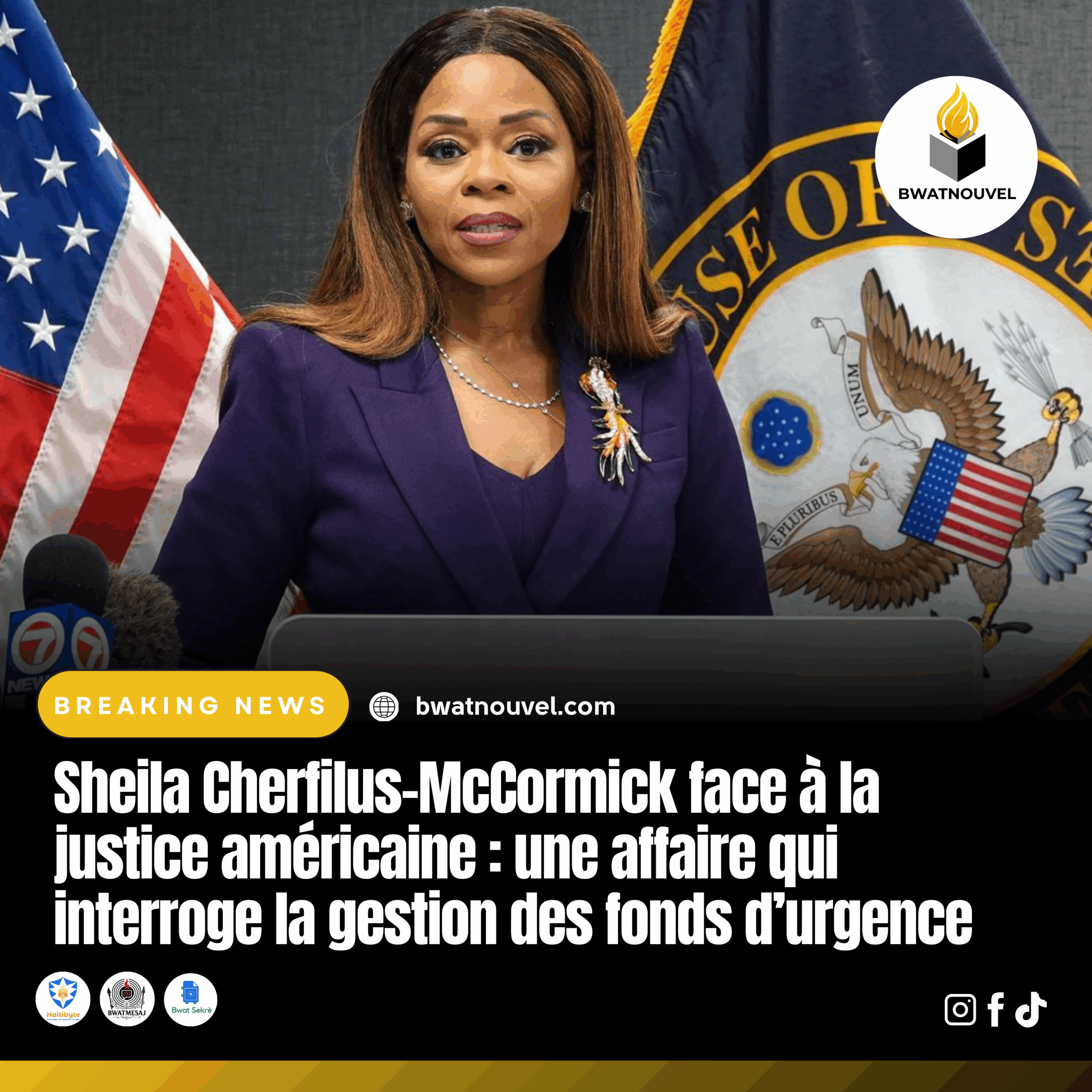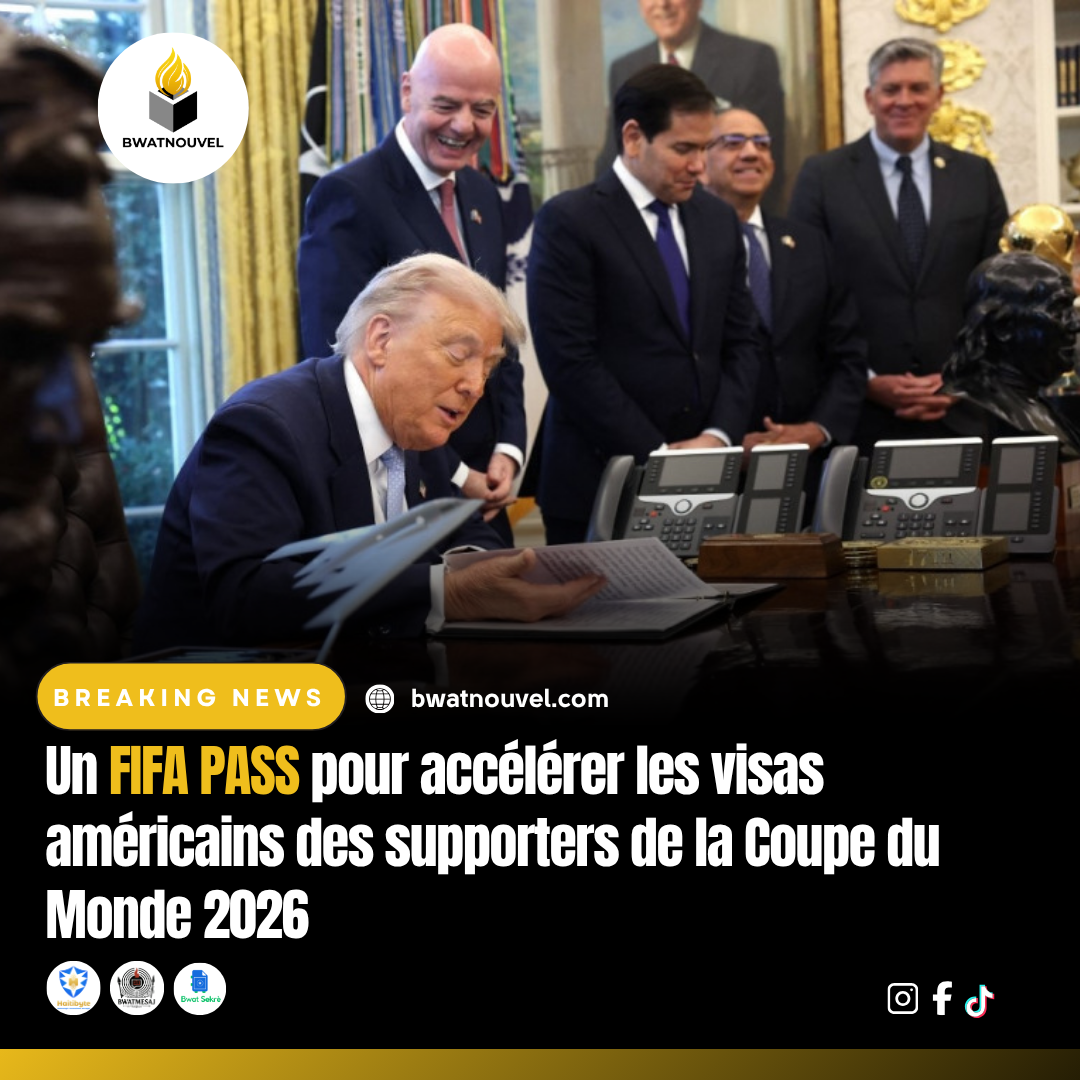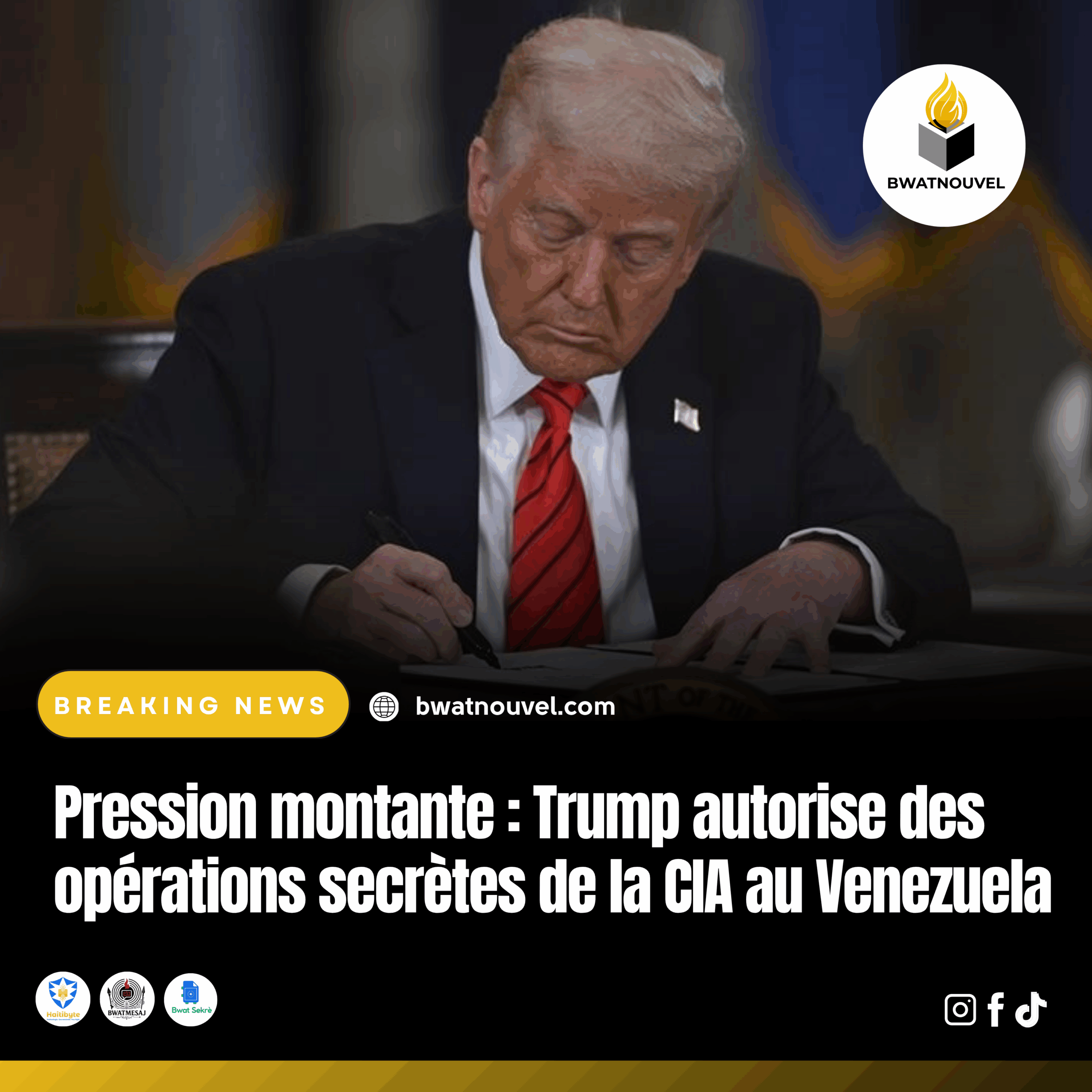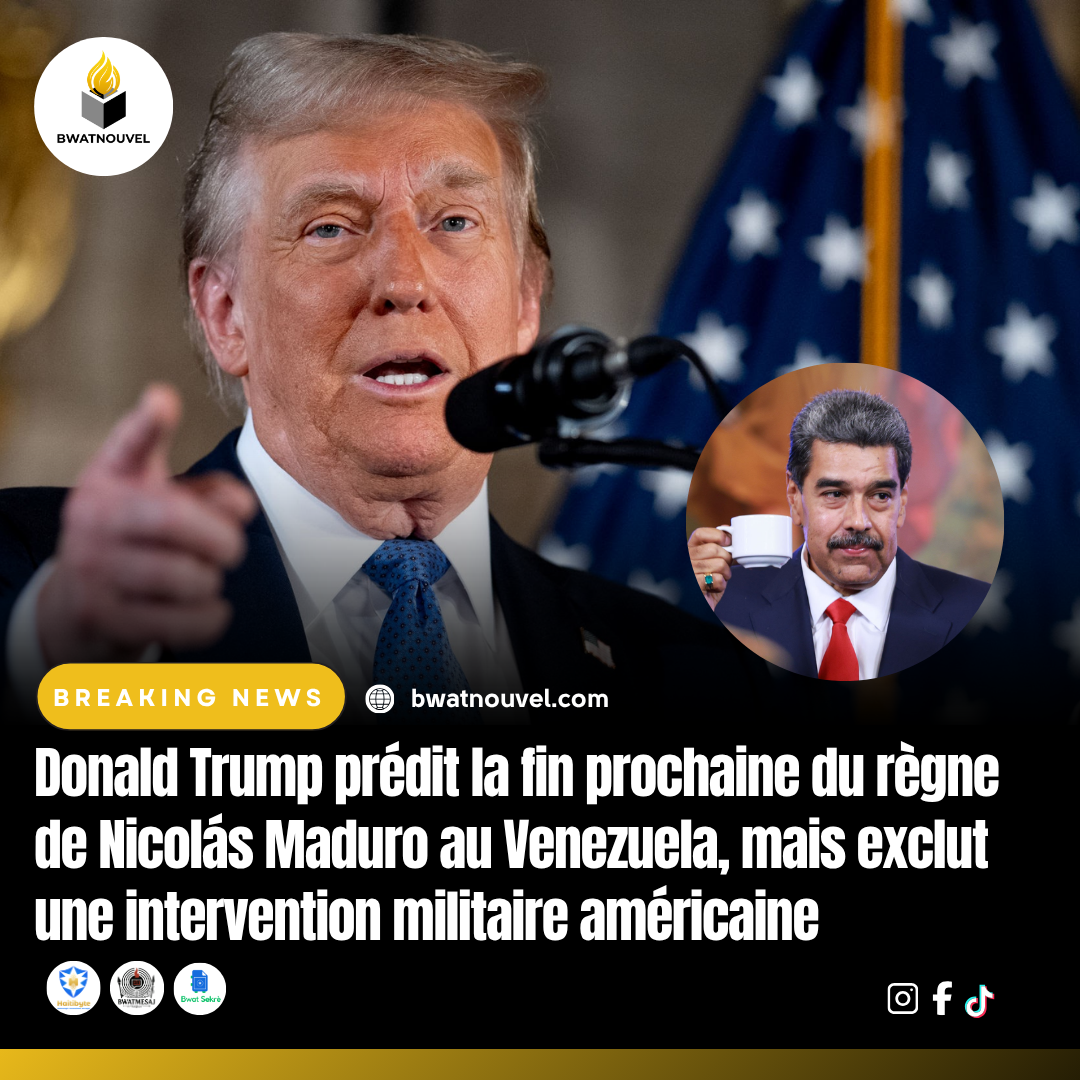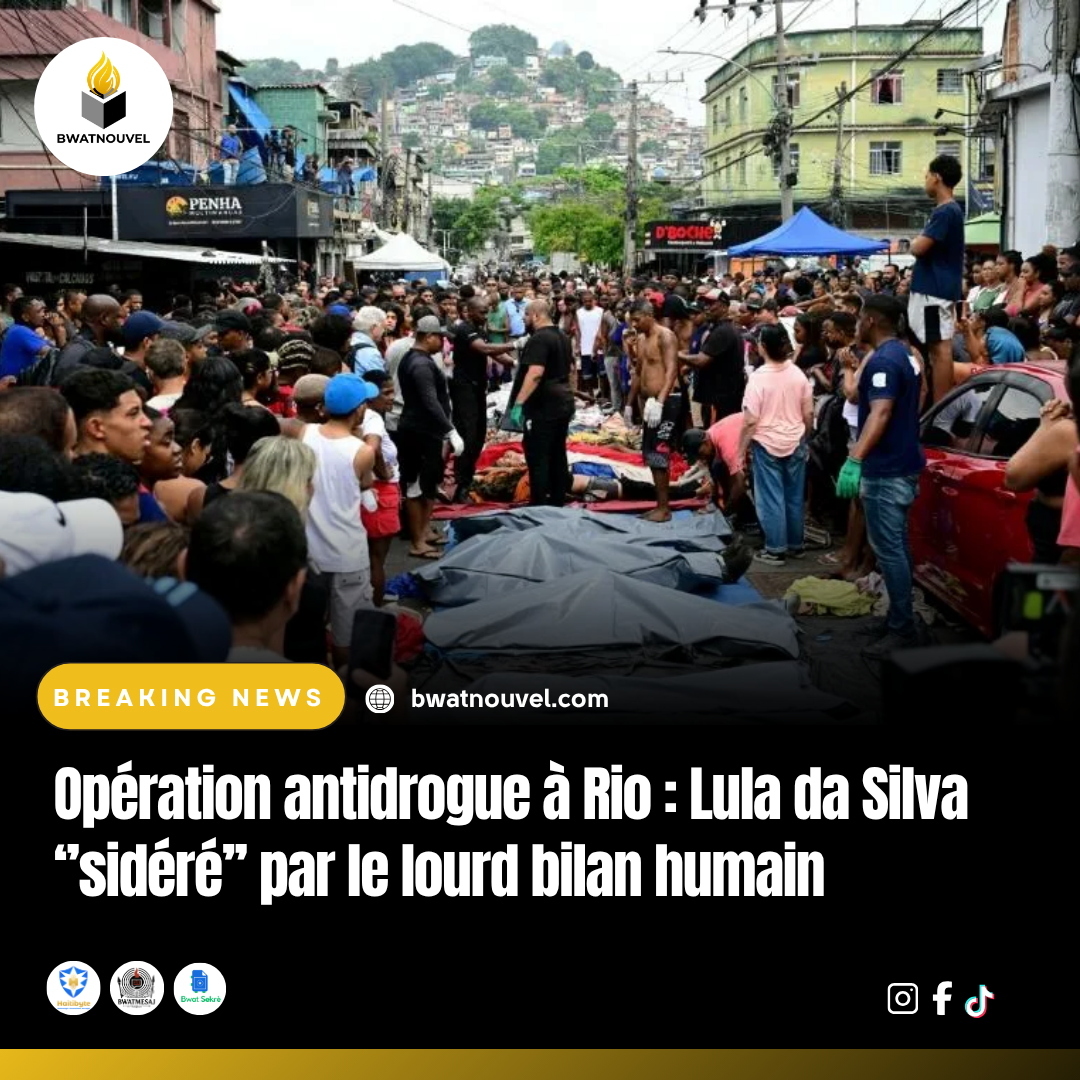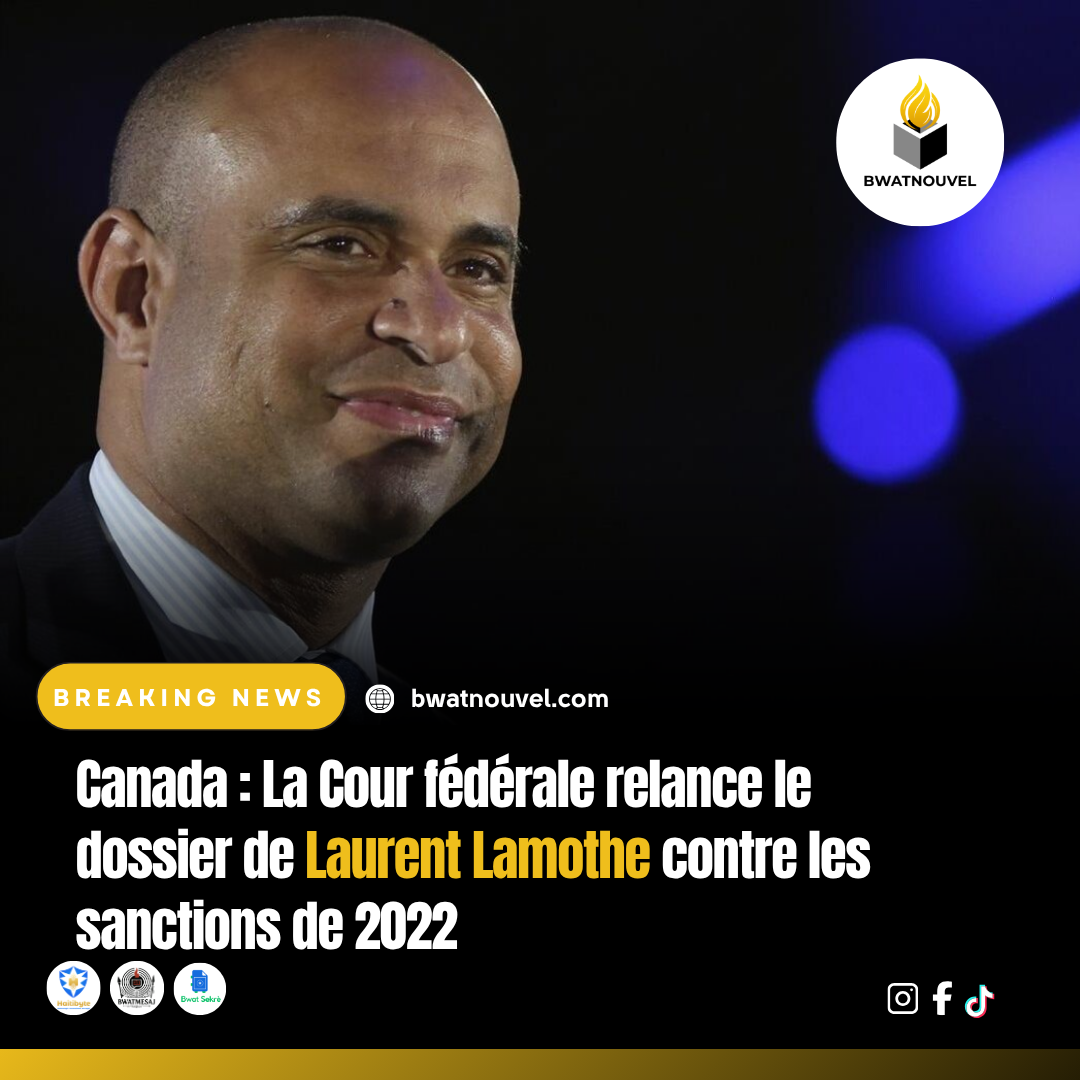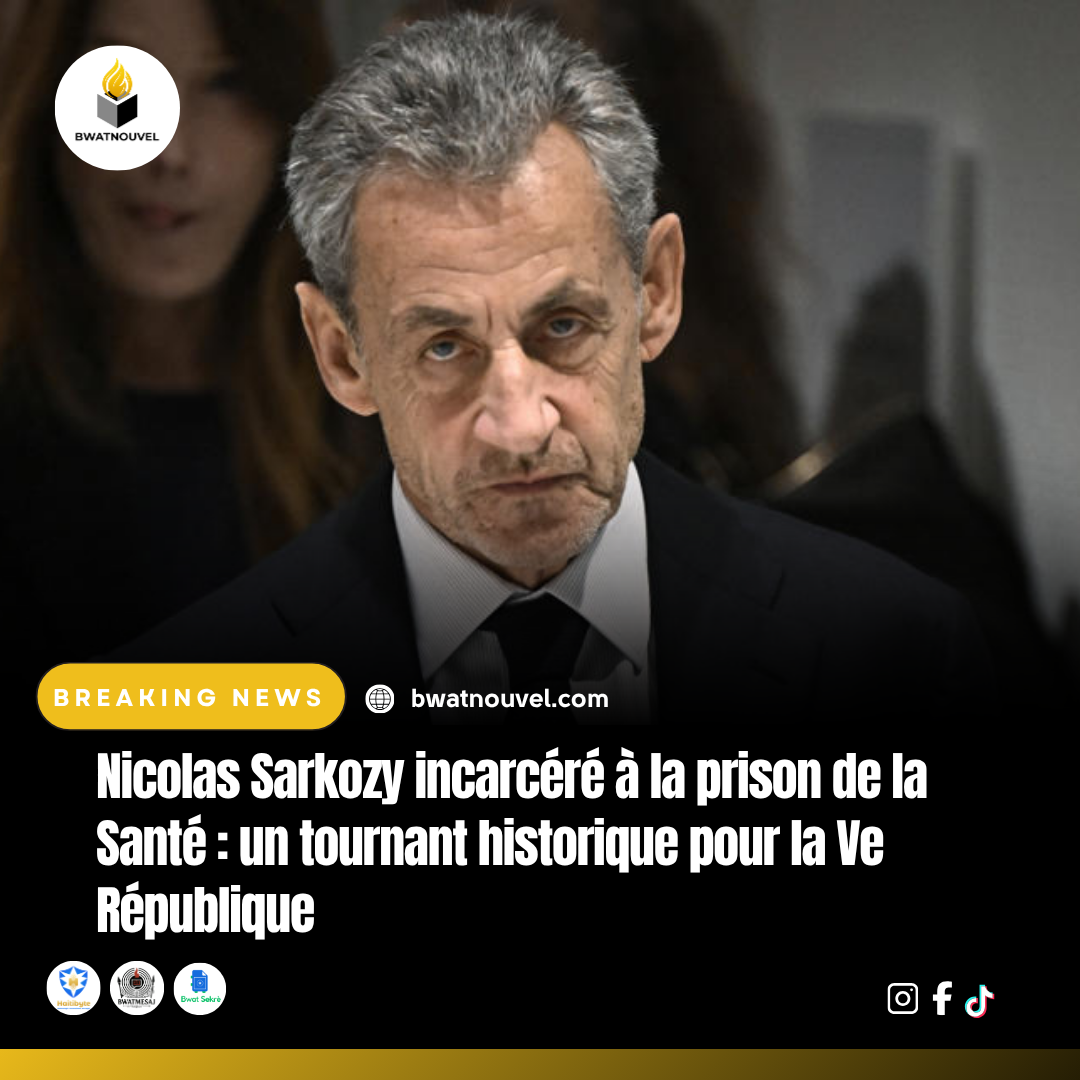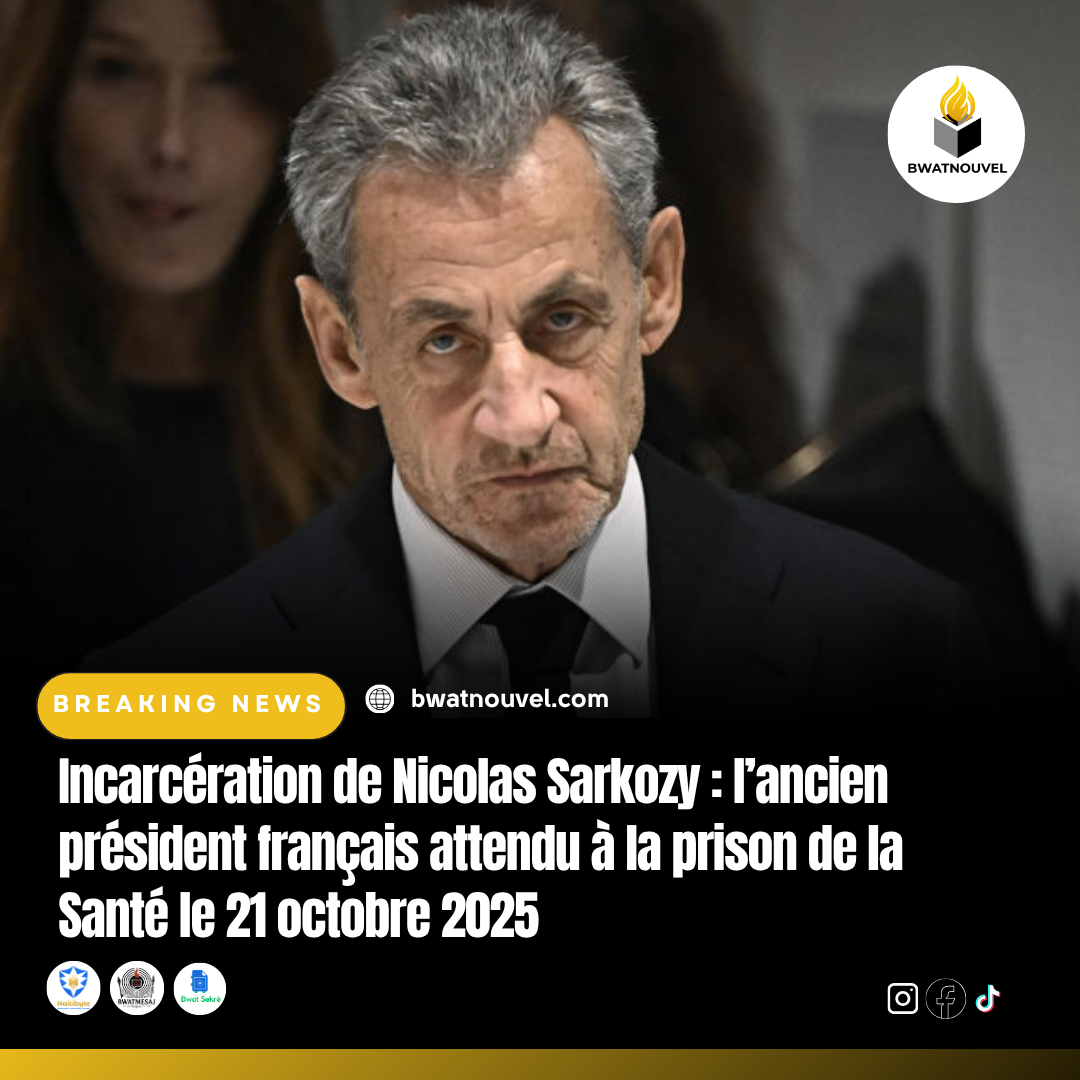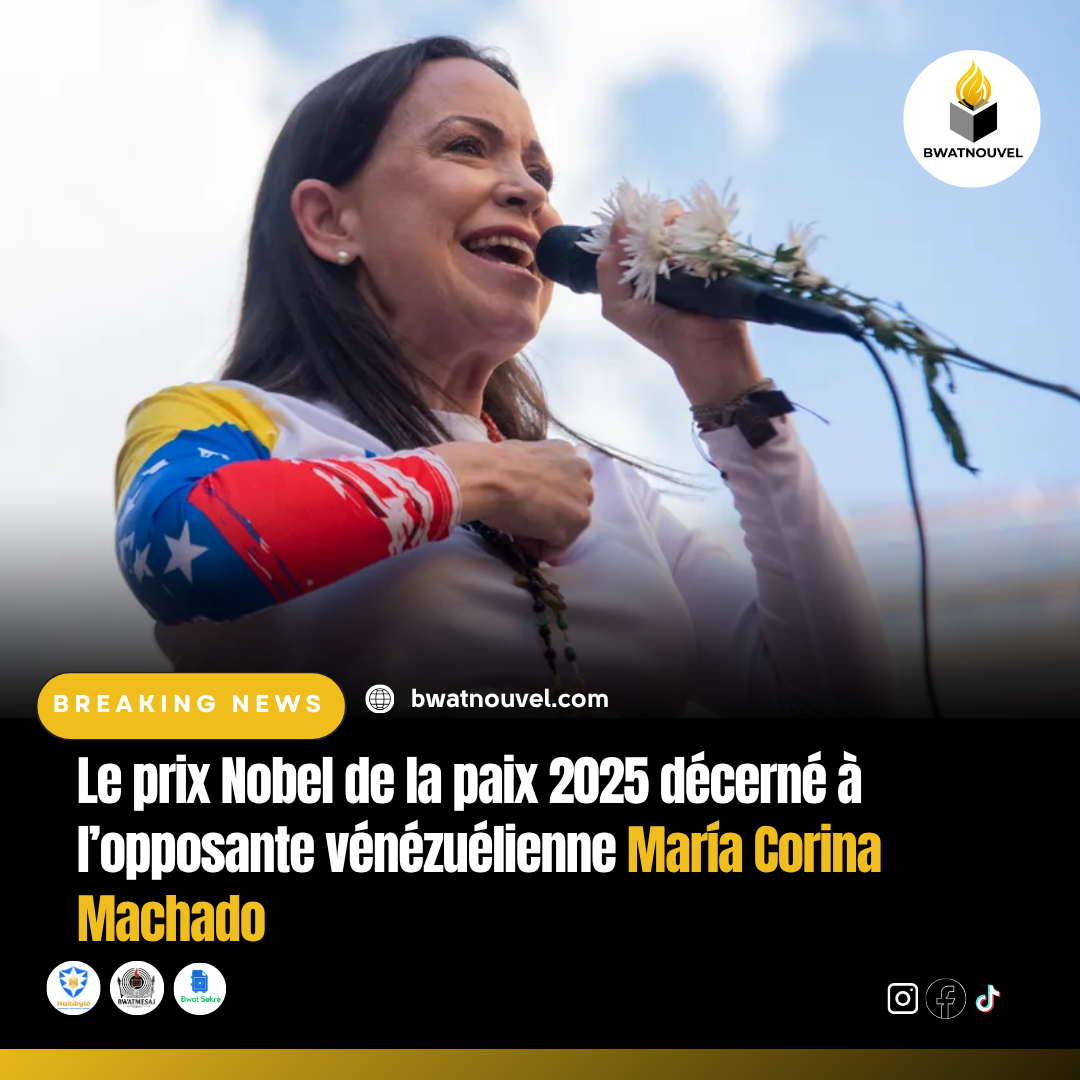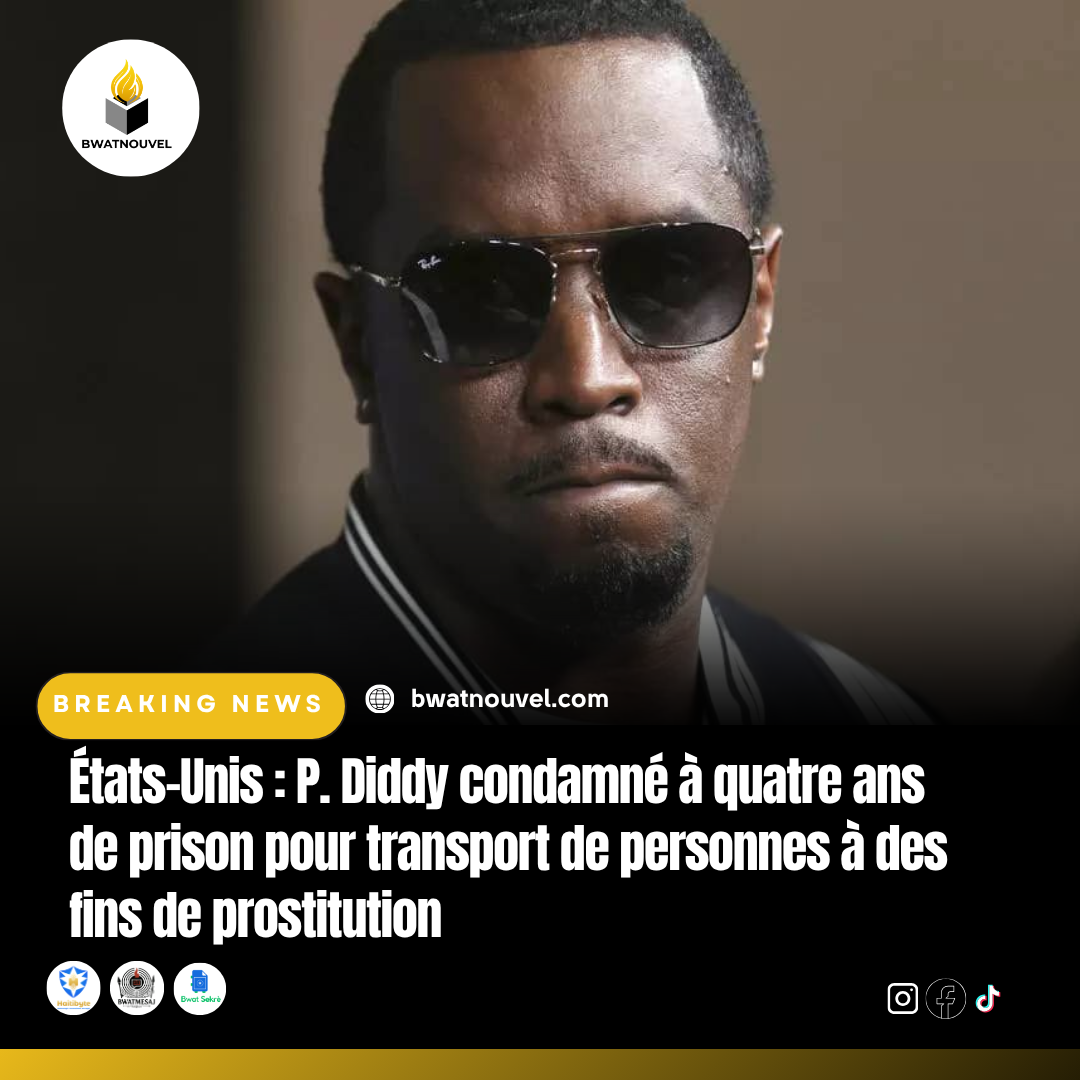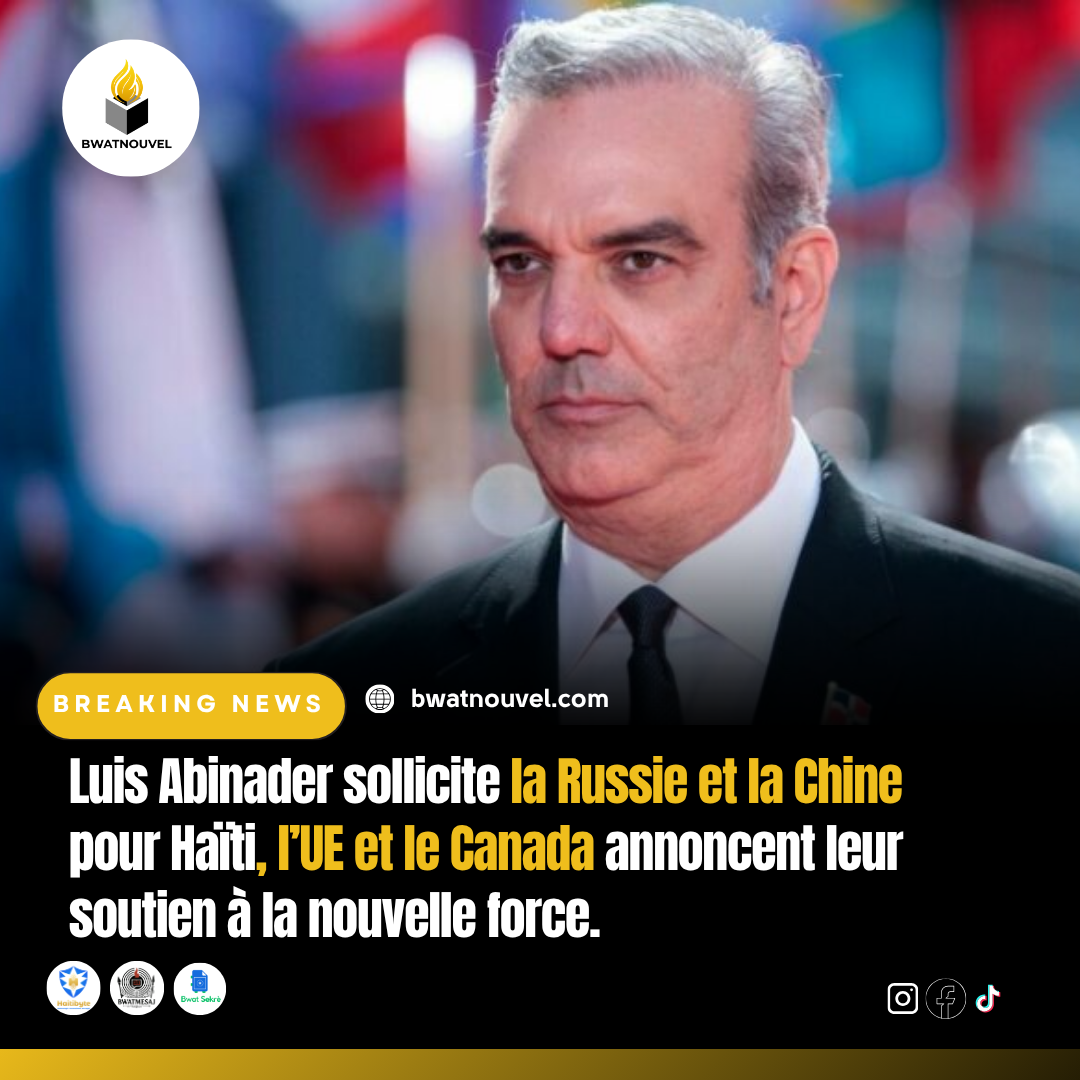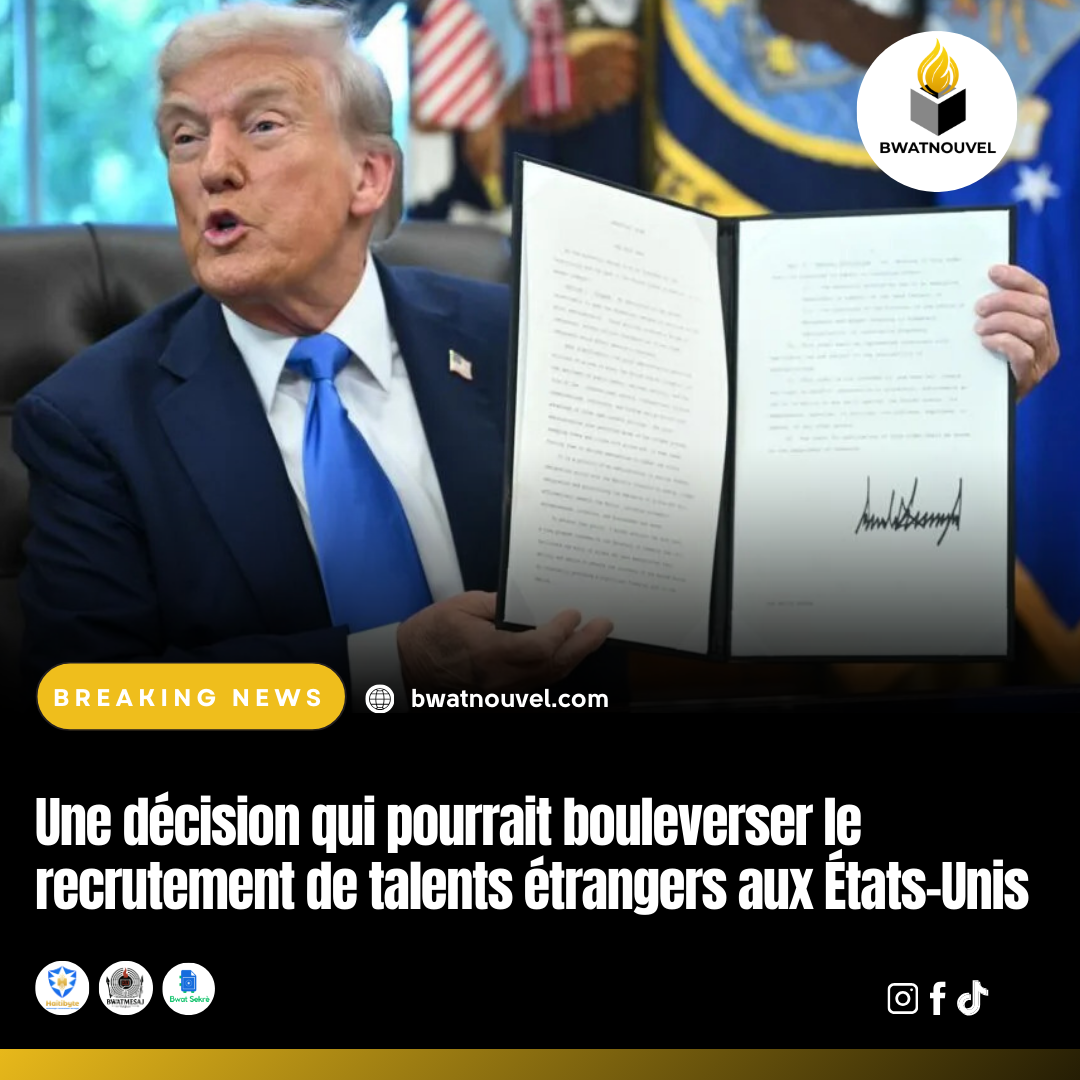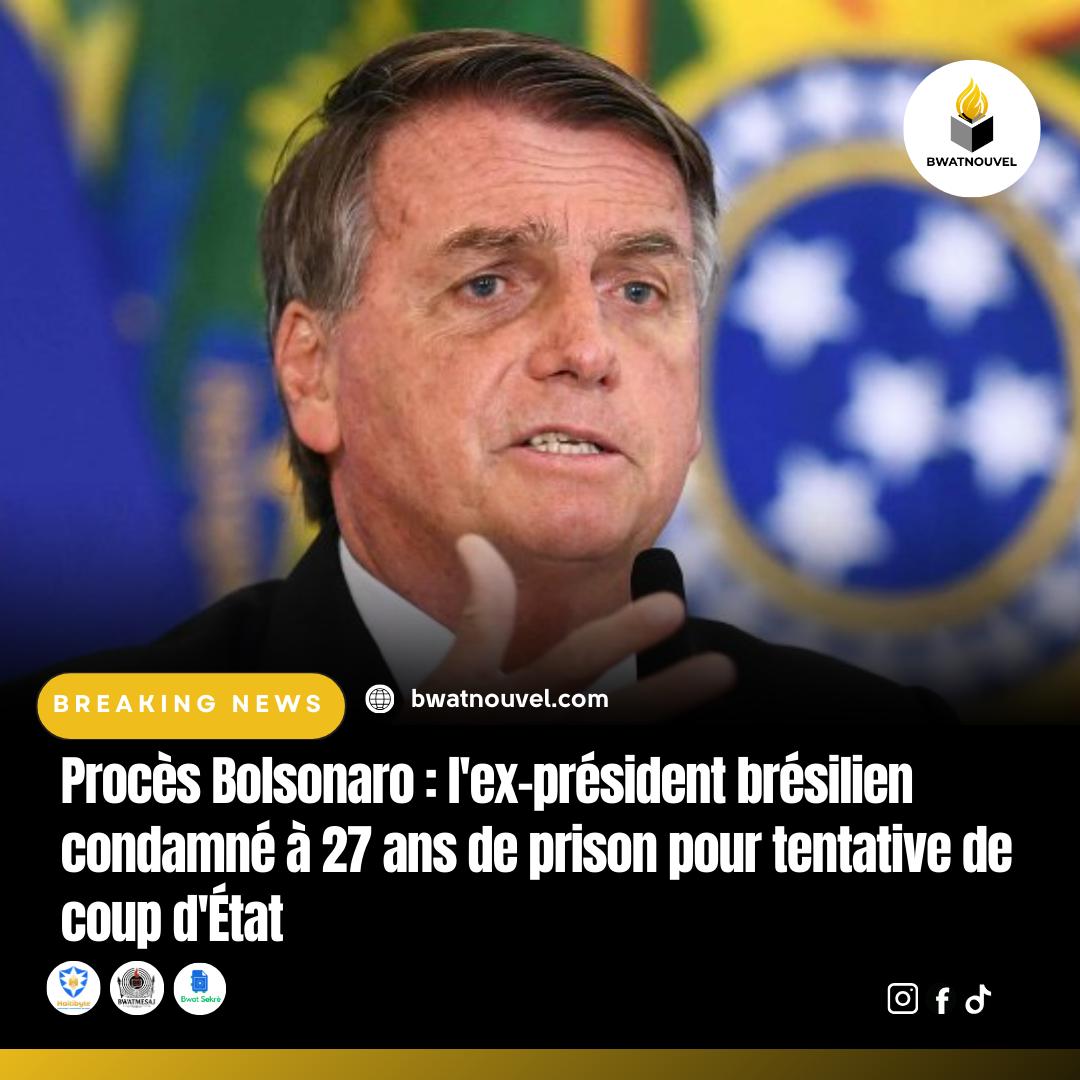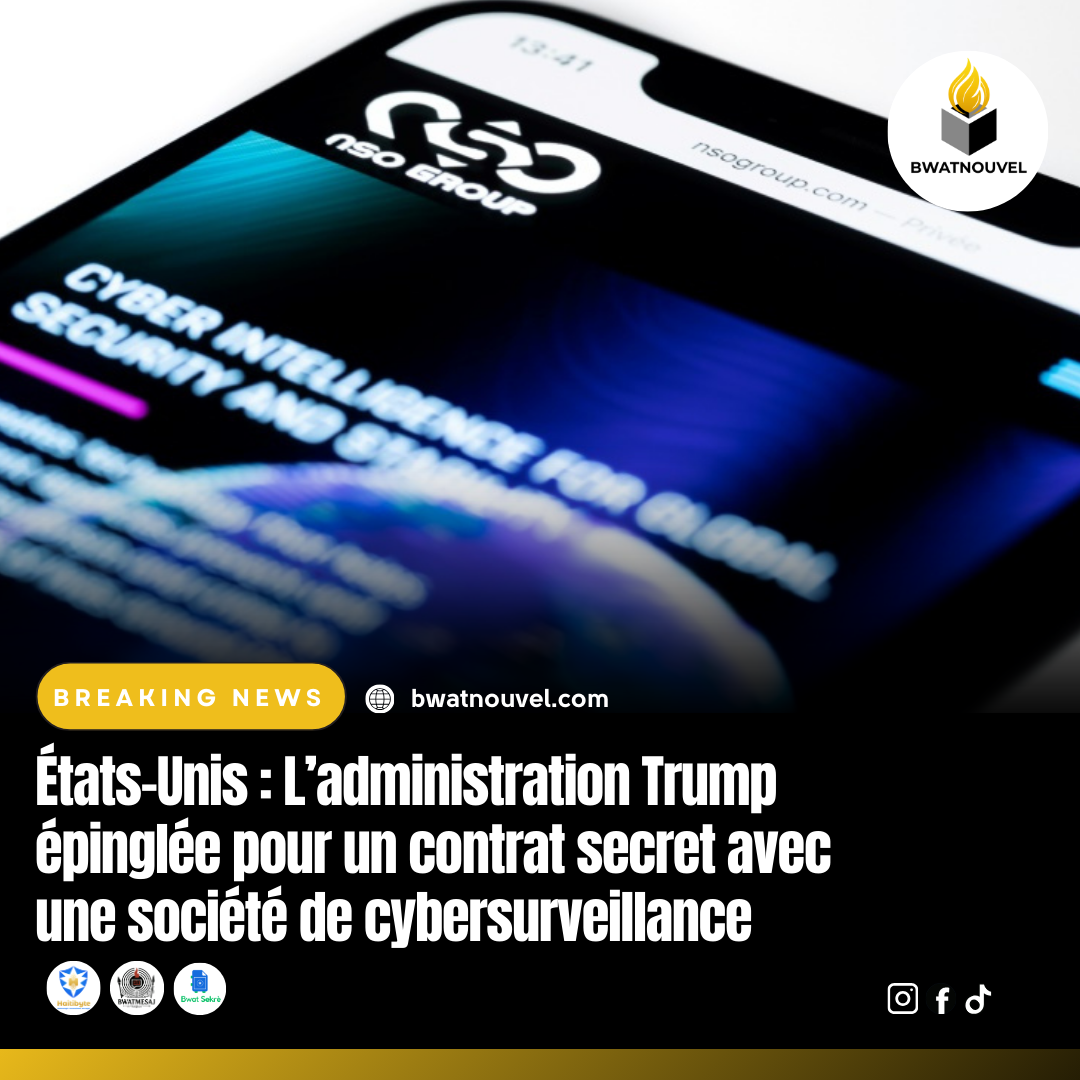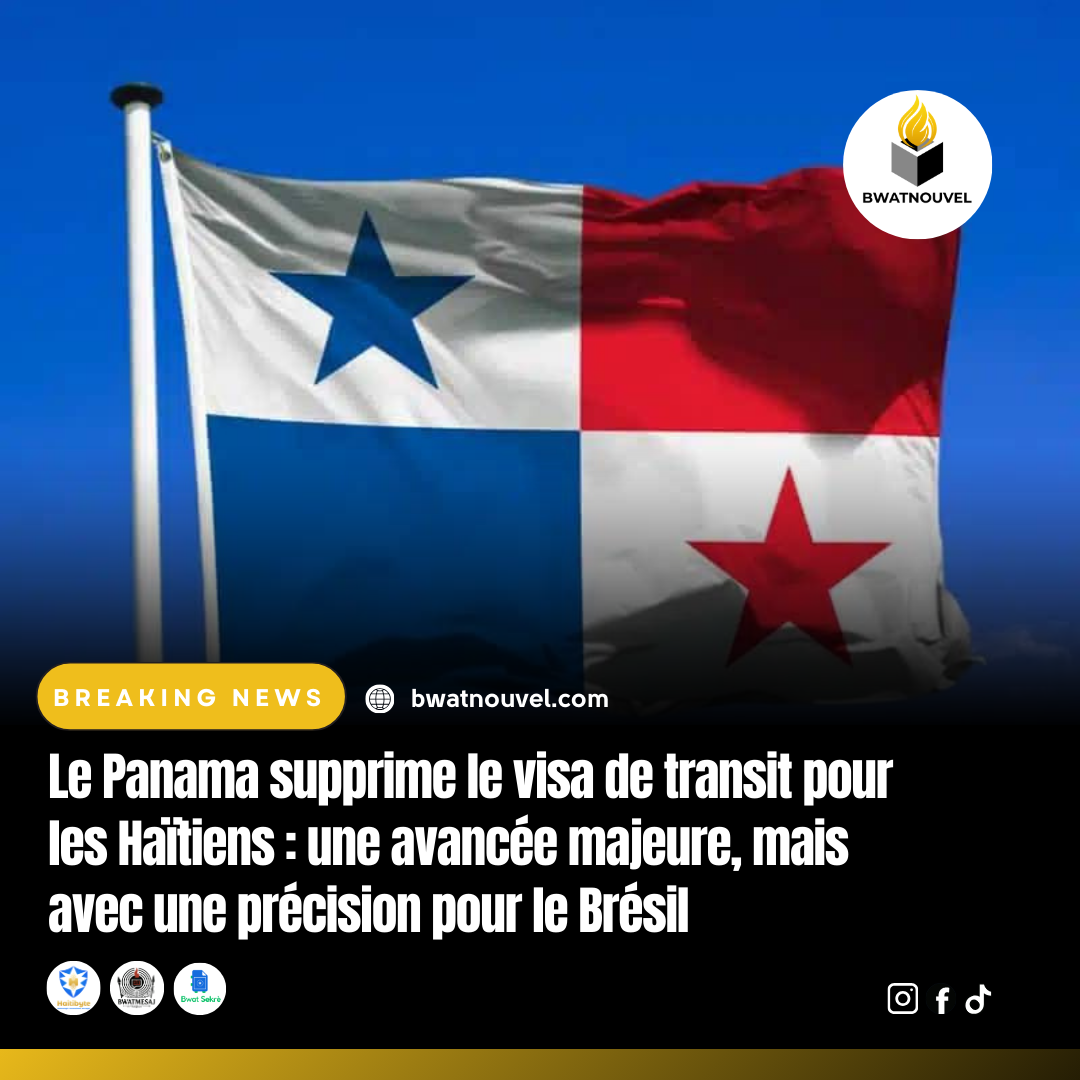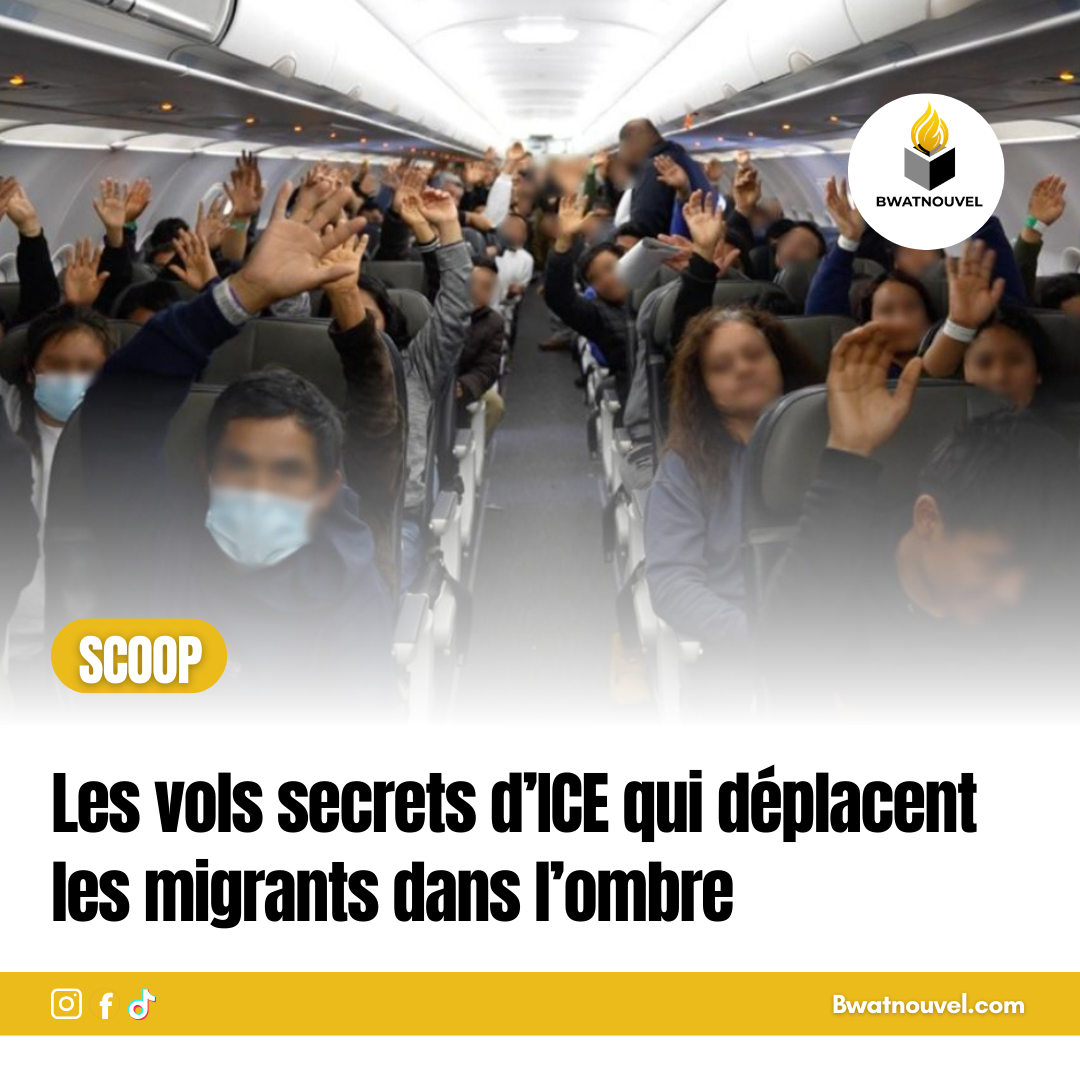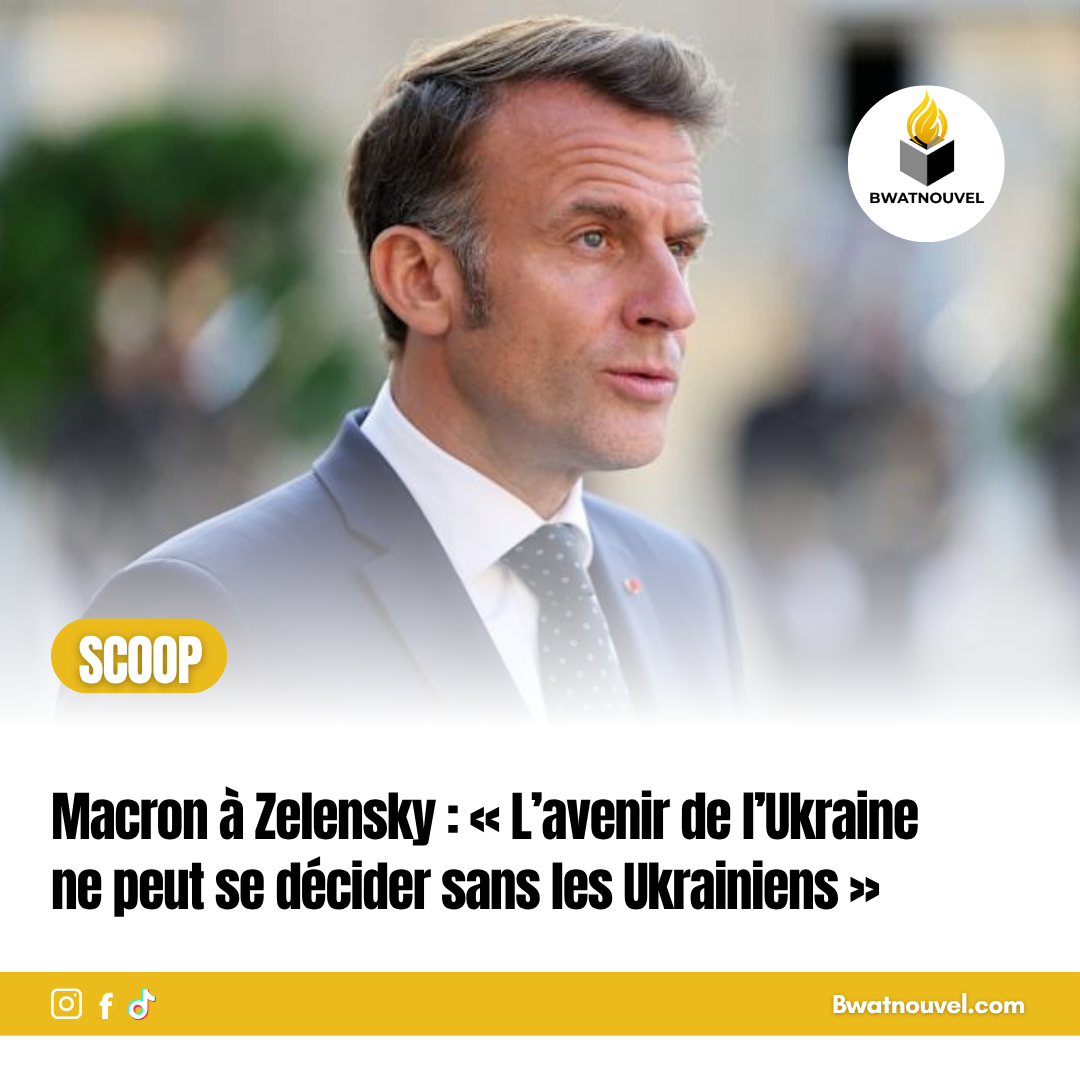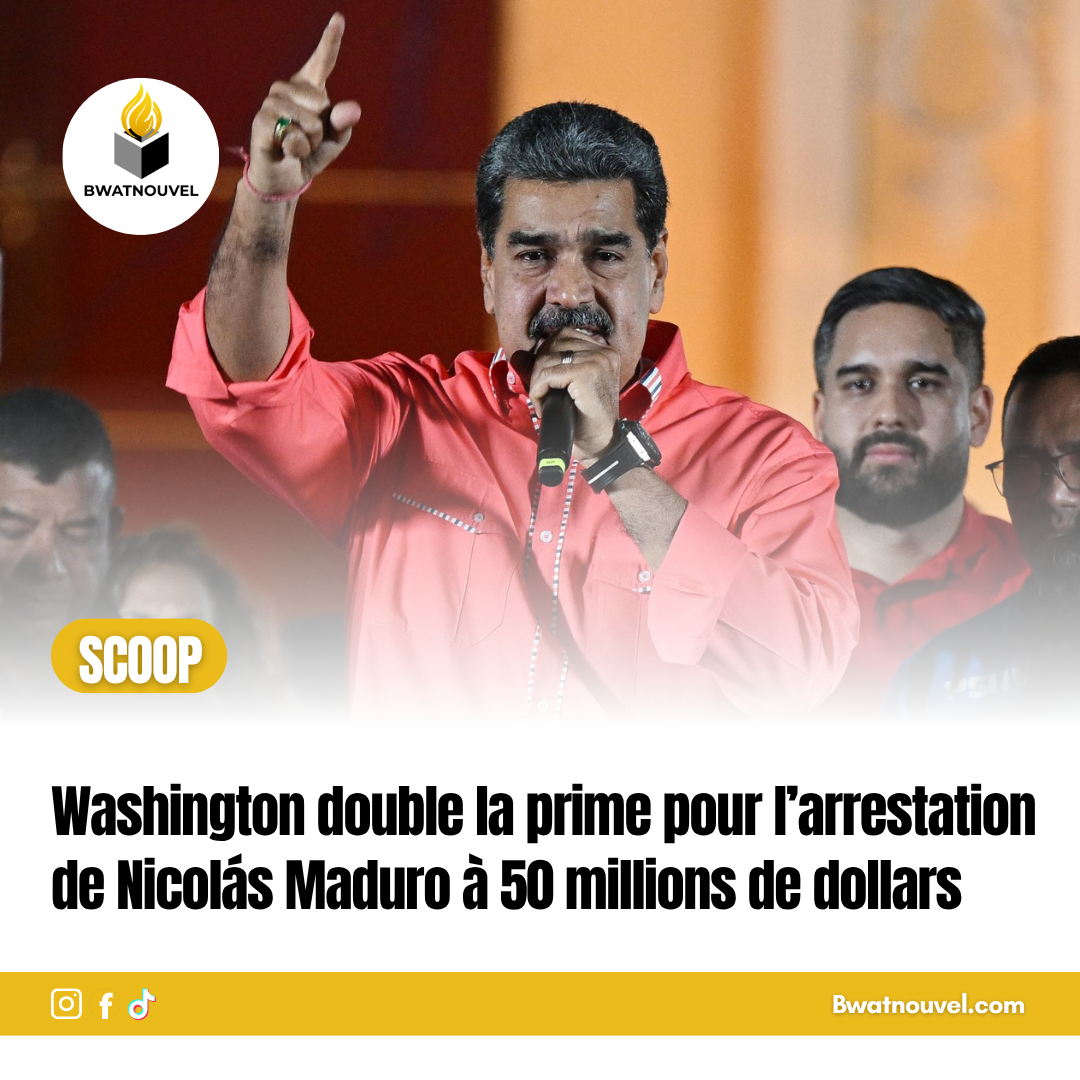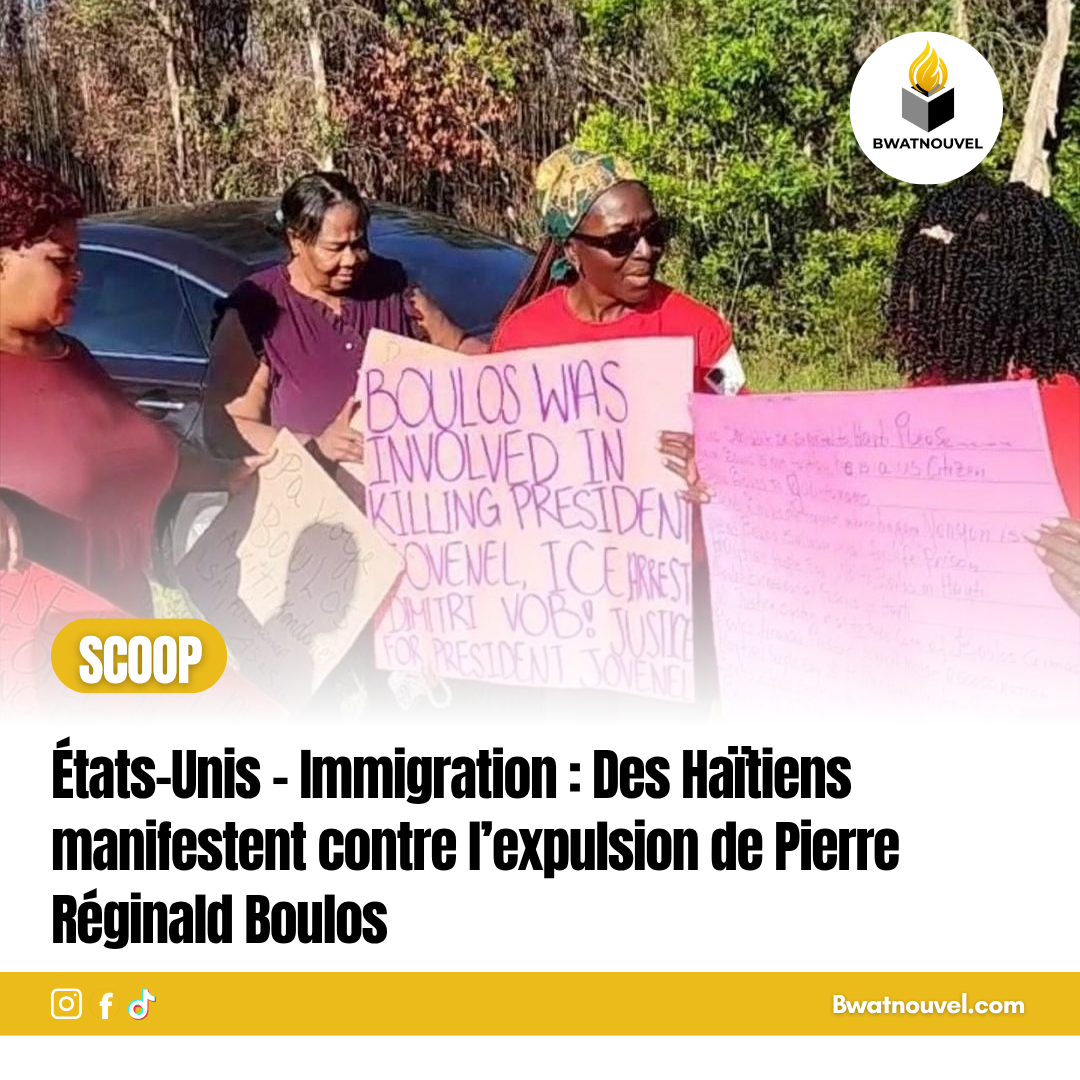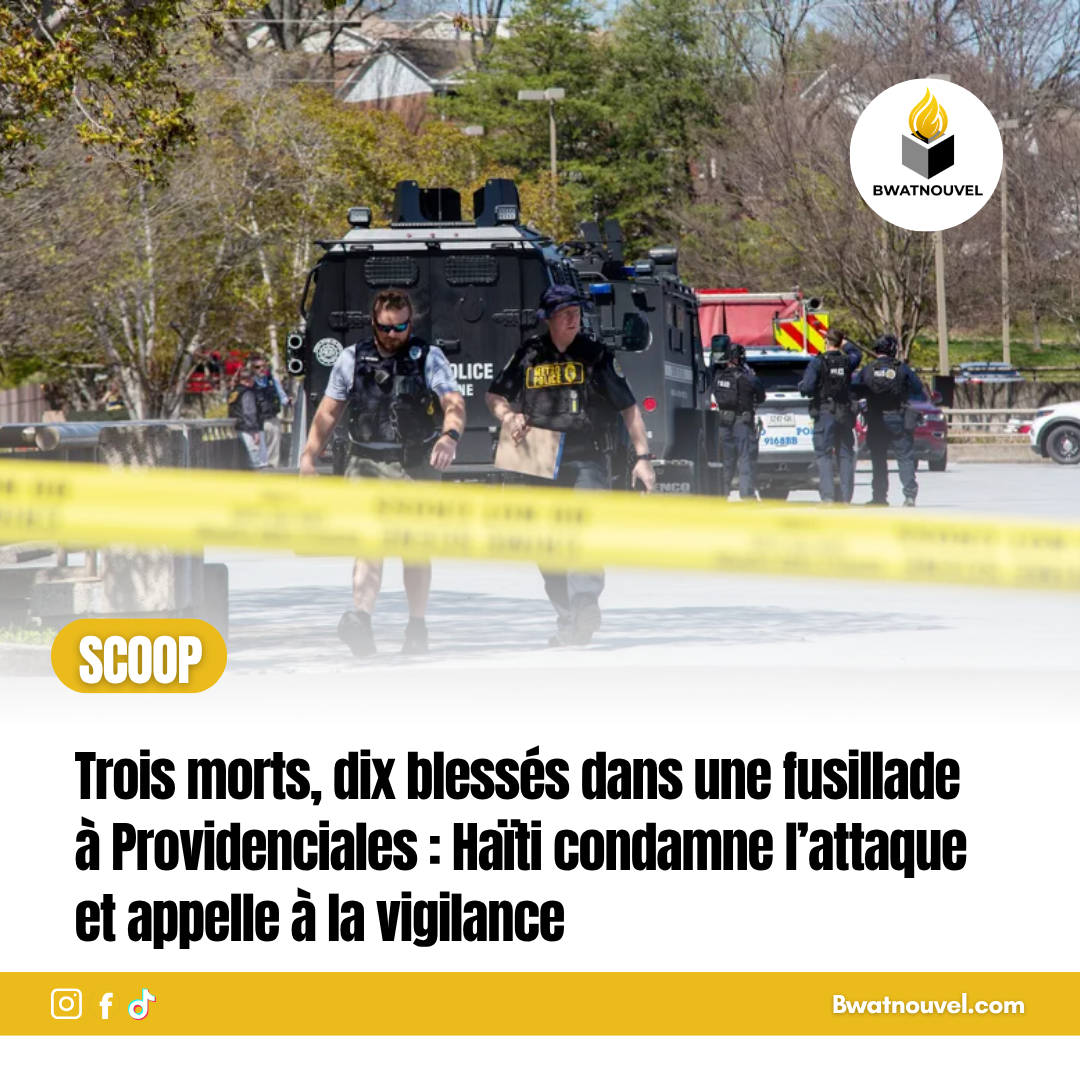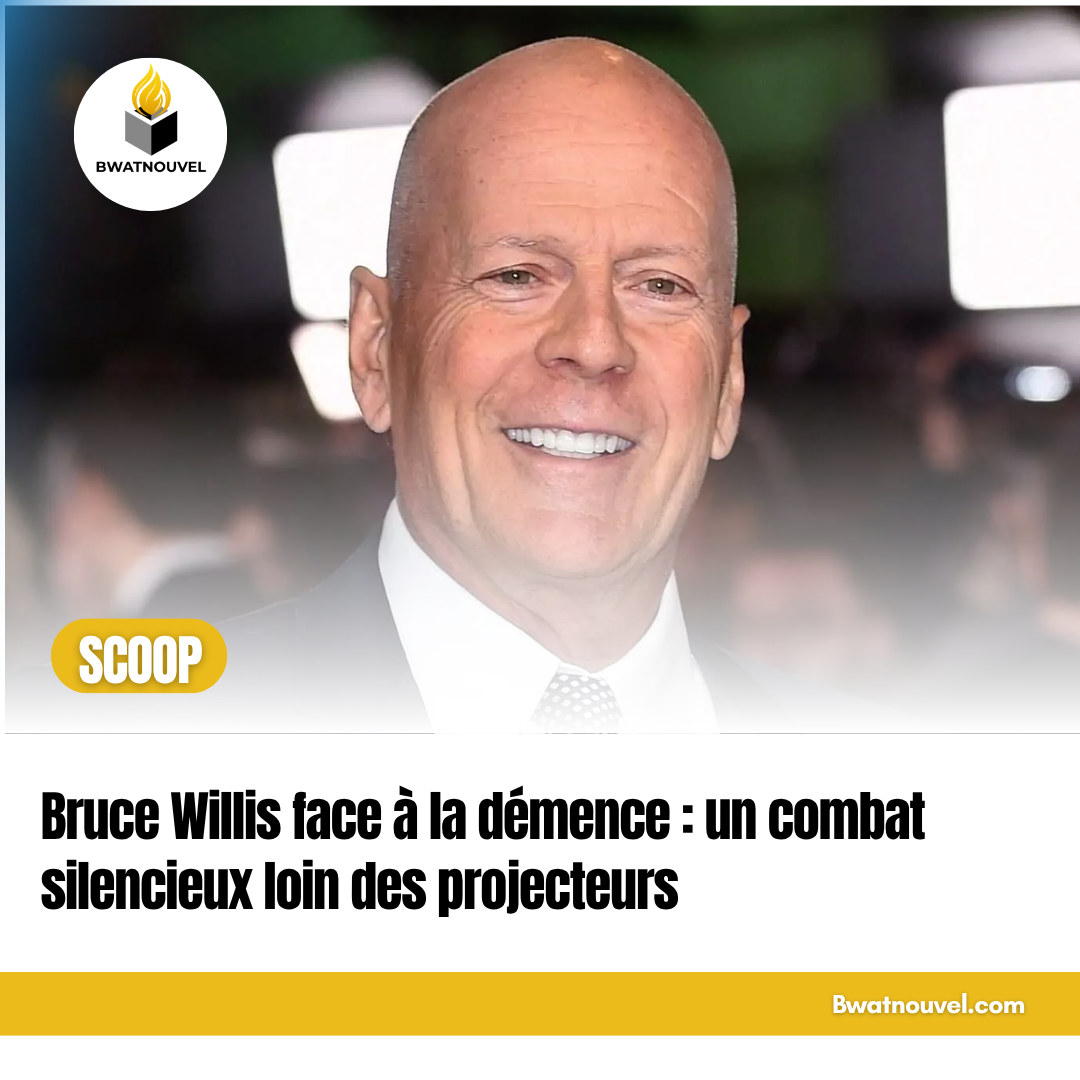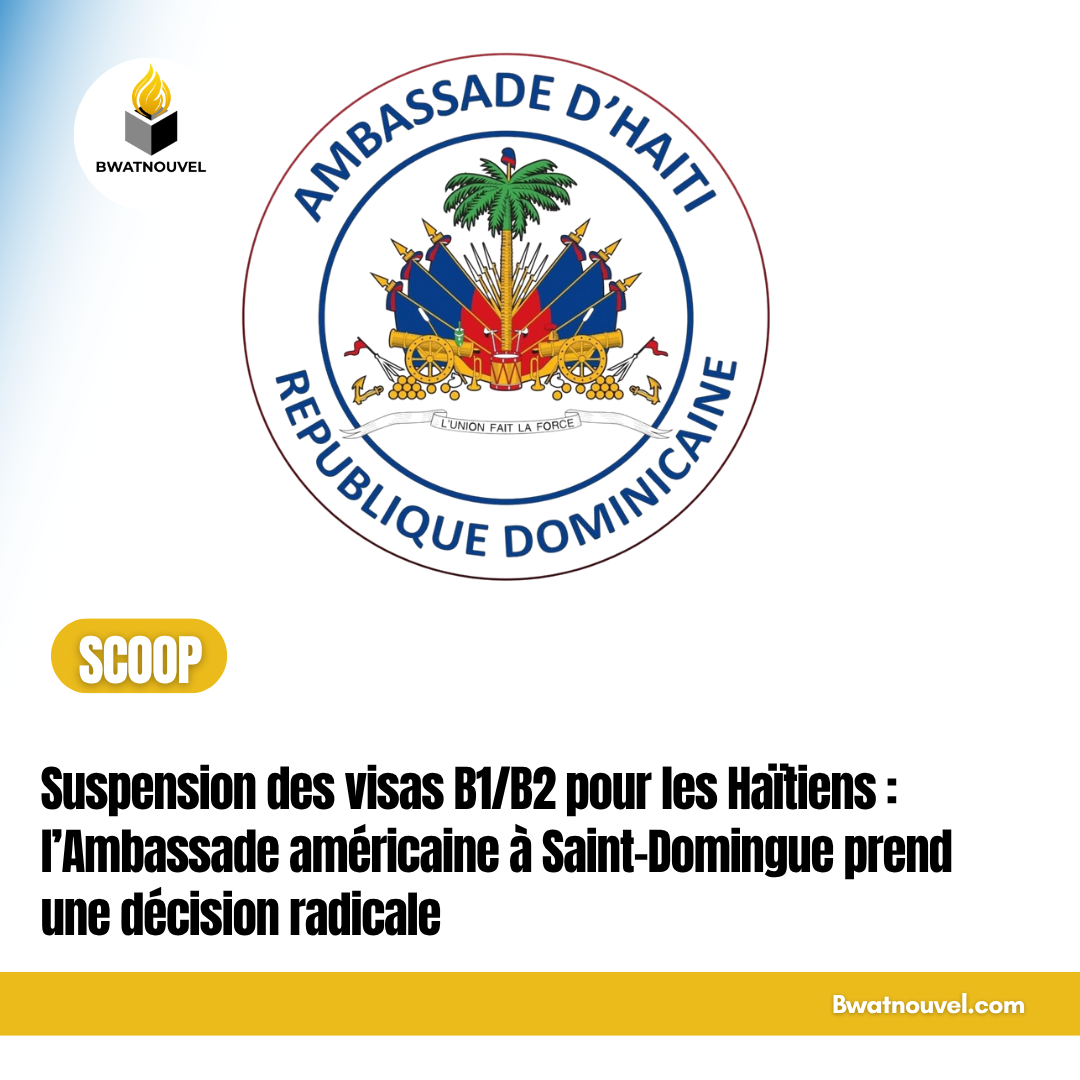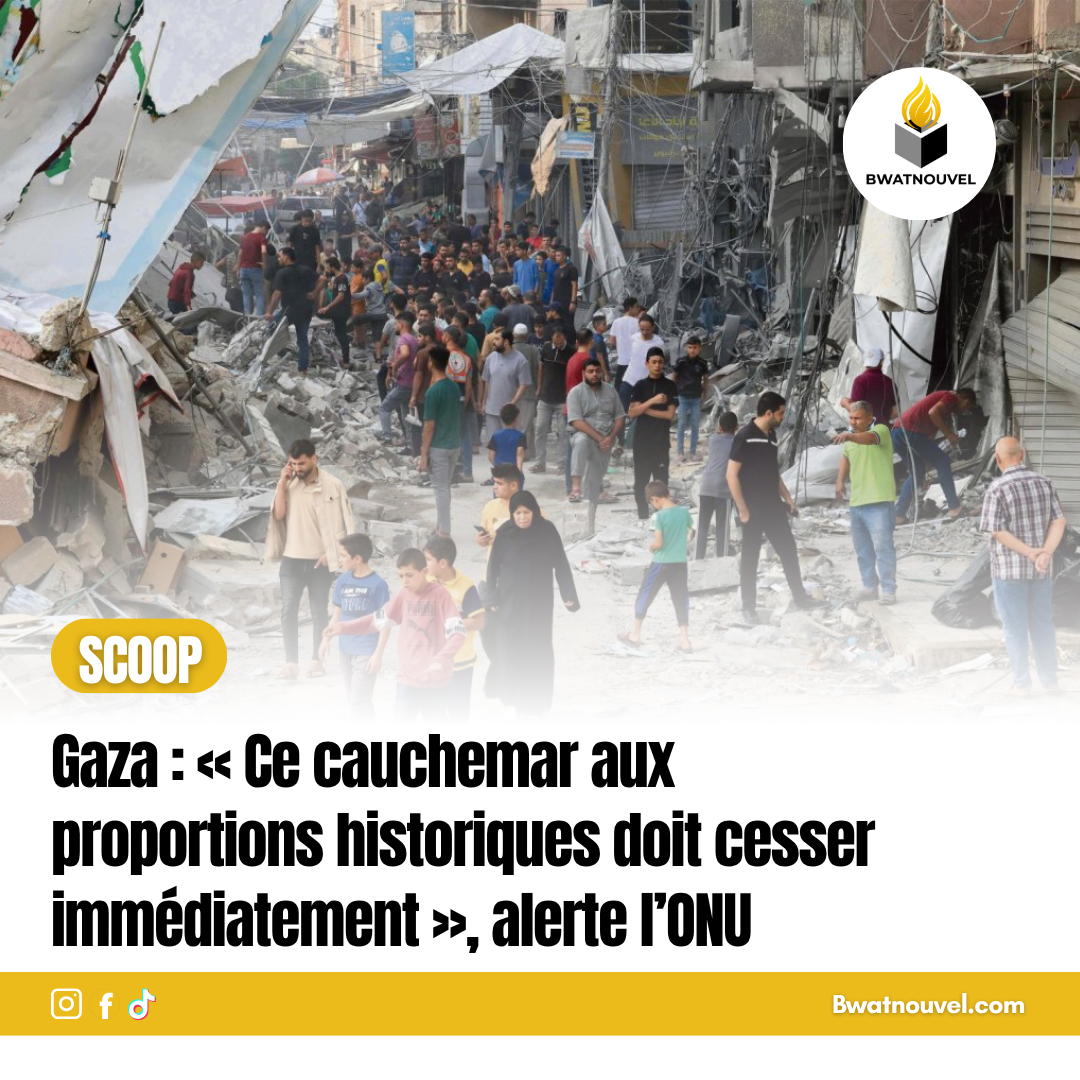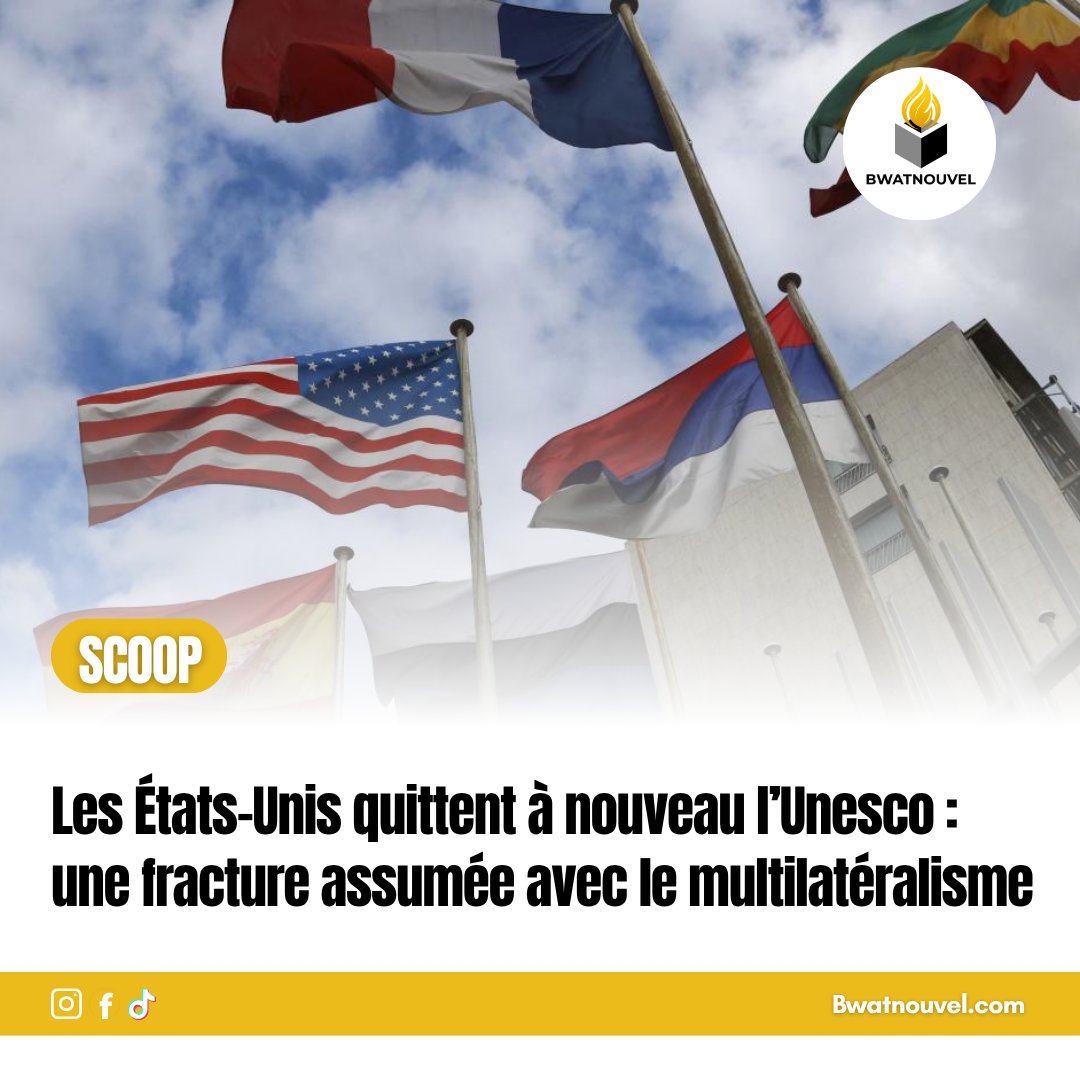Trump envisage l’état d’urgence : vers une militarisation des villes américaines ?
Une initiative controversée
Le président américain Donald Trump envisage de déclarer l’état d’urgence afin de déployer l’armée dans plusieurs grandes villes du pays. Officiellement, il s’agit de « rétablir l’ordre » face à la criminalité et aux troubles civils.
Cependant, de nombreux observateurs y voient une tentative d’étendre le pouvoir exécutif, au risque de fragiliser les équilibres démocratiques.
Un contexte explosif
Depuis plusieurs semaines, des tensions grandissantes agitent des métropoles comme Chicago, Portland et Los Angeles.
Trump accuse les autorités locales, majoritairement démocrates, de « laisser leurs villes sombrer dans l’anarchie ». Pour justifier son initiative, il invoque l’Insurrection Act, une loi du XIXe siècle autorisant le président à déployer l’armée sur le sol national en cas de crise majeure.
Le magnat républicain affirme vouloir « protéger les citoyens » et « restaurer la paix ». Pourtant, plusieurs responsables locaux dénoncent une démarche autoritaire, politiquement motivée et contraire à l’esprit fédéral américain.
Des obstacles juridiques et institutionnels
L’initiative de Trump se heurte à de nombreuses contestations.
Certains juges fédéraux ont suspendu des déploiements, estimant qu’ils violent la Constitution et le Posse Comitatus Act, qui limite l’usage de l’armée pour le maintien de l’ordre civil.
Des gouverneurs, comme celui de l’Illinois, ont saisi la justice pour bloquer les interventions fédérales dans leurs États.
Plusieurs experts rappellent que la sécurité intérieure relève d’abord des autorités locales. Toute ingérence militaire sans coordination constitue un précédent dangereux.
Les critiques politiques et citoyennes
Les opposants dénoncent une stratégie électoraliste. Selon eux, Trump chercherait à projeter l’image d’un « homme fort » avant les prochaines échéances politiques.
Des organisations de défense des droits civiques mettent en garde contre la militarisation de la vie publique, soulignant les risques de répression et d’atteinte aux libertés fondamentales.
Certains partisans considèrent toutefois cette initiative « nécessaire » pour ramener l’ordre dans des villes « abandonnées par la gauche ».
Les conséquences possibles
Si l’état d’urgence est déclaré, le gouvernement fédéral pourrait déployer des troupes sans l’accord des autorités locales.
Une telle décision provoquerait un bras de fer institutionnel inédit entre Washington et les États fédérés. Elle risquerait d’aggraver la polarisation politique déjà profonde.
L’image internationale des États-Unis pourrait aussi être ternie, donnant l’impression d’un État militarisé plutôt que d’une démocratie apaisée.
Conclusion
La volonté de Donald Trump d’imposer l’ordre par la force révèle une vision radicale du pouvoir présidentiel.
Si la sécurité est une priorité légitime, son usage ne peut justifier la remise en cause des principes constitutionnels ni l’affaiblissement des institutions locales.
Dans une démocratie, la stabilité ne se construit pas sous la menace des armes, mais dans le respect du droit et du dialogue civique.Obstacles juridiques à l’état d’urgence et limites constitutionnelles
Brinia ELMINIS